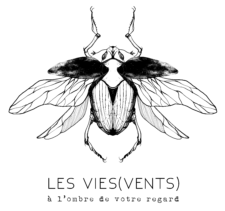récit photographique

Mélissa, 23 ans
D‘aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais aimé mon corps, je ne me suis jamais aimée. Je n’acceptais pas les compliments, je les trouve infondés. Enfant, j’étais différente des autres filles : plus grande et plus forte, je ne me retrouvais ni en elles, ni avec elles. En grandissant, j’ai tenté d’effacer mon existence, ma présence, en devenant silencieuse et discrète, n’aimant ni le regard des autres, ni le mien. Ces regards n’étaient pas forcément hostiles, mais je me sentais jugée, évaluée sur ma simple apparence, sur mon comportement. Par tous, même sans que cela soit volontaire. Je voulais disparaître. Je me haïssais réellement, m’énervant contre moi-même, m’insultant intérieurement. Je ne m’aimais pas et aucun compliment ne me faisait changer d’avis.
Puis, adolescente, je suis tombée amoureuse. J’ai appris à accepter qu’on puisse m’aimer, sans comprendre pour autant pourquoi. Je ne correspondais toujours pas « aux critères » des autres, de la société, des publicités, comme certaines filles maquillées, voulant plaire et gloussant. Je ne me sentais pas « fille ». Cela me semble encore aujourd’hui un concept inconnu, lointain. Mais, puisque quelqu’un m’aimait, c’est que je n’étais pas si horrible que ça. J’aurais aimé voir avec ses yeux celle qu’il regardait. Elle semblait bien mieux. Le fait de se découvrir l’un l’autre, c’était aussi se découvrir différemment.
En 2009, je suis tombée malade. J’avais 16 ans. A partir de là, les choses ont réellement changé : j’ai perdu le contrôle de mon corps et de mon image. On n’apparaît plus comme on le souhaite quand son corps décide de s’arrêter. Moi qui ne voulais pas attirer l’attention, j’en suis devenue le centre. Mon corps s’est affublé progressivement d’attelles et de bandages. Je me suis mise à boiter, je ne pouvais plus faire certaines choses. Je n’étais plus apte à écrire. Je me suis sentie coincée dans mon corps. J’ai refusé le mot «handicap», j’ai refusé les regards de mon entourage, mes camarades, tout le monde : un mélange entre pitié, peine et incompréhension. J’ai refusé leur aide. Ce fut une sombre période de déconstruction de moi, de mes liens avec le reste du monde. La plupart des médecins, dépassés face à mon mal peu (re)connu, m’ont traitée de «comédienne». C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me détacher du regard des autres parce que je souffrais de leur jugement. J’étais en colère. Un médecin se doit de soigner, pas de juger, non ? J’ai construit des barrières contre tous. Le rire est devenu ma réponse à leur bêtise : je riais pour ne pas pleurer, je riais d’être incomprise, non reconnue. Je riais pour encaisser.
Par la suite le verdict est tombé : j’ai un handicap. J’ai une fibromyalgie : c’est un dérèglement des neurotransmetteurs envoyant des messages de douleur H24 à mon cerveau sans cause et donc sans fin. Cela provoque une fatigue chronique, des troubles du moral et du sommeil entre autres. Ça ne se soigne pas. Il faut apprendre à vivre avec. Ah. Il faut écouter son corps, ne pas aller au-delà de ses limites. Ah. Je n’ai plus les manettes, c’est lui qui décide. C’est aussi lui qui dicte mes relations car me connaître relève de l’engagement, me fréquenter, être ami avec moi, c’est accepter que je ne puisse pas tout faire. Je me fatigue vite ; je ne peux que peu marcher, il faut parfois porter mes affaires. Souvent, on nous observe. Il faut me faire manger quand je ne peux plus lever les bras. On entend les gens nous critiquer parce qu’on prend l’ascenseur « alors que c’est pour les personnes âgées et/ou handicapées ». Mon handicap est invisible, mais ça n’empêche pas les autres de me juger. Ceux qui sont restés m’ont dit qu’on s’ « en foutait du regard des Autres : que ces inconnus ne me connaissaient pas »
Et puis, j’ai fini en fauteuil. Cette période fut difficile. J’ai perdu des amis, qui ont dû voir en moi une charge. Je n’ai jamais demandé pourquoi. Je me serais abandonnée si j’avais pu. Je me suis sentie seule et isolée. J’ai été déscolarisée pendant plusieurs mois, faute d’aménagements de cours adaptés. Je suis tombée en dépression.
Je n’ai plus souffert directement des jugements. J’étais arrivée à un stade où j’étais blasée. Je voyais ce qui se tramait autour de moi, mais j’avais des choses plus importantes à gérer. En même temps, quand une vieille femme avec une canne vous double en montant une côte, on ne peut qu’être blasé. Pourtant j’ai souffert de l’impact que ça avait sur ma famille. Ma mère n’a pas supporté le regard des gens sur moi. Elle fusillait du regard quiconque me fixait «comme une bête de foire» ou nous esquivait. Elle, le roc, a pleuré et moi, la raison de tout ça, j’ai dû la consoler. Je n’ai pas supporté de faire subir ça aux gens que j’aime. Mon père n’accepte toujours pas ma situation. Il n’accepte pas son handicap d’ailleurs, ni le regard des autres. Il n’y a pas de lien entre nos handicaps. Le sien est visible : il a eu un accident et a perdu l’usage d’un bras. Mais étant très manuel, il n’a jamais accepté cette perte. Il ne supporte pas que je me plante fièrement avec mon étiquette «handicapée» aujourd’hui, alors que lui se dérobe.
Moi qui me trouvais toujours grosse, j’ai perdu beaucoup de poids pendant cette période, au point de ressembler à un «zombie» d’après mes proches, toujours plus inquiets.
J’étais toujours en révolte contre moi-même et contre les autres : les profs peu compréhensifs, les administrations qui semblent vouloir nous enfoncer davantage. En même temps, je me suis mise à accepter ceux qui nous tendent toutes les mains possibles, nous regardent dans les yeux et non pas dans les roues.
J’ai fini par quitter le fauteuil et reprendre du poids. Du coup, je me suis à nouveau trouvée grosse. Éternelle insatisfaite. Néanmoins, une transformation s’était opérée. J’ai commencé mes études supérieures et j’ai appris à m’ouvrir aux autres. J’avais fini par accepter de dépendre désormais d’eux, j’ai décidé d’apprendre à les connaître. Et ils m’ont surpris ! L’amour que j’ai pu lire dans leurs regards, le respect aussi parce qu’ils nous trouvent courageux.
En raison de ma santé, j’ai dû arrêter mes études. Nouvelle révolte contre mon corps. N’en pouvant plus de cette situation, j’ai entrepris un travail sur moi-même avec une multitude de professionnels (médecins ou infirmières) tous avec des spécialités propres : psychologie, réflexologie, ostéopathie, kinésithérapie, sophrologie… Un de mes problèmes concernait autant mon « je – nous » que mon genou. Avec eux, j’ai cherché à savoir pourquoi je ne m’aimais pas, pourquoi je n’acceptais pas ce que j’étais et donc ce que je pouvais renvoyer comme image. Celle d’une jeune femme froide, indépendante. J’ai eu du mal : une partie d’entre eux me voyaient toujours comme une comédienne mais certains ont eu ce regard lumineux qui aide à relever la tête.
C’était en 2011. Aujourd’hui, cinq ans après je suis toujours malade, mais je vais bien. J’ai appris à accepter mon corps, voir à l’aimer partiellement. Je ne me trouve ni moche ni grosse, juste moi. Je ne me compare plus aux autres. Je suis une fille sans répondre aux clichés de l’étudiante ou aux « normes socialement admises », je suis simple et naturelle. Je suis. C’est tout ce qui compte réellement.
Aujourd’hui, j’ai appris à faire sans le regard des autres. Je ne suis plus aussi timide. Je suis plus expressive et plus souriante. Je dis des bêtises, j’agis comme si personne ne me regardait. Je me moque de ce qu’on pense de moi. Je me suis fait tatouer pour dire à mon corps que je l’accepte. J’ai enfin compris qu’il y aura toujours des gens qui ne m’aimeront pas et d’autres qui m’accepteront telle que je suis. Toutefois, je n’arrive toujours pas à accepter un compliment. Je ne le remarque pas si je plais à quelqu’un. Je n’aime pas le regard des hommes sur moi. Je préfère ne pas le voir. Il est gênant. Il me renvoie une image sexualisée qui ne me plaît pas, que je n’assume pas.
Je pense qu’être tombée malade est finalement une bonne chose. C’est bizarre de dire ça, mais ça m’a aidé à avancer, à mieux vivre avec moi-même. La vie est assez compliquée : évitons-nous ces attentes inutiles que nous croyons que les autres ont de nous. C’est mon impression. Je ne suis pas tout un tas de choses, et alors ?
J’ai encore du travail à faire sur moi-même, je le sais. Je ne m’aime pas encore, pas assez. Mais j’évolue, avec les autres. J’écoute mon corps. Ma santé s’est même améliorée, donc je tends vers l’harmonie. La preuve que j’ai changé : je suis prête à me faire prendre en photo alors que j’avais jusque-là toujours esquivé.
Finalement, le regard des autres ça se soigne.
Note *Mélissa utilise beaucoup « nous » car elle considère qu’elle fait partie d’un ensemble de personnes qui se battent pour eux-mêmes et que c’est cet ensemble qui est « courageux », pas elle. Cette généralisation lui permet de dire à la première personne du pluriel des choses qu’il lui serait impossible autrement.
Puis, adolescente, je suis tombée amoureuse. J’ai appris à accepter qu’on puisse m’aimer, sans comprendre pour autant pourquoi. Je ne correspondais toujours pas « aux critères » des autres, de la société, des publicités, comme certaines filles maquillées, voulant plaire et gloussant. Je ne me sentais pas « fille ». Cela me semble encore aujourd’hui un concept inconnu, lointain. Mais, puisque quelqu’un m’aimait, c’est que je n’étais pas si horrible que ça. J’aurais aimé voir avec ses yeux celle qu’il regardait. Elle semblait bien mieux. Le fait de se découvrir l’un l’autre, c’était aussi se découvrir différemment.
En 2009, je suis tombée malade. J’avais 16 ans. A partir de là, les choses ont réellement changé : j’ai perdu le contrôle de mon corps et de mon image. On n’apparaît plus comme on le souhaite quand son corps décide de s’arrêter. Moi qui ne voulais pas attirer l’attention, j’en suis devenue le centre. Mon corps s’est affublé progressivement d’attelles et de bandages. Je me suis mise à boiter, je ne pouvais plus faire certaines choses. Je n’étais plus apte à écrire. Je me suis sentie coincée dans mon corps. J’ai refusé le mot «handicap», j’ai refusé les regards de mon entourage, mes camarades, tout le monde : un mélange entre pitié, peine et incompréhension. J’ai refusé leur aide. Ce fut une sombre période de déconstruction de moi, de mes liens avec le reste du monde. La plupart des médecins, dépassés face à mon mal peu (re)connu, m’ont traitée de «comédienne». C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me détacher du regard des autres parce que je souffrais de leur jugement. J’étais en colère. Un médecin se doit de soigner, pas de juger, non ? J’ai construit des barrières contre tous. Le rire est devenu ma réponse à leur bêtise : je riais pour ne pas pleurer, je riais d’être incomprise, non reconnue. Je riais pour encaisser.
Par la suite le verdict est tombé : j’ai un handicap. J’ai une fibromyalgie : c’est un dérèglement des neurotransmetteurs envoyant des messages de douleur H24 à mon cerveau sans cause et donc sans fin. Cela provoque une fatigue chronique, des troubles du moral et du sommeil entre autres. Ça ne se soigne pas. Il faut apprendre à vivre avec. Ah. Il faut écouter son corps, ne pas aller au-delà de ses limites. Ah. Je n’ai plus les manettes, c’est lui qui décide. C’est aussi lui qui dicte mes relations car me connaître relève de l’engagement, me fréquenter, être ami avec moi, c’est accepter que je ne puisse pas tout faire. Je me fatigue vite ; je ne peux que peu marcher, il faut parfois porter mes affaires. Souvent, on nous observe. Il faut me faire manger quand je ne peux plus lever les bras. On entend les gens nous critiquer parce qu’on prend l’ascenseur « alors que c’est pour les personnes âgées et/ou handicapées ». Mon handicap est invisible, mais ça n’empêche pas les autres de me juger. Ceux qui sont restés m’ont dit qu’on s’ « en foutait du regard des Autres : que ces inconnus ne me connaissaient pas »
Et puis, j’ai fini en fauteuil. Cette période fut difficile. J’ai perdu des amis, qui ont dû voir en moi une charge. Je n’ai jamais demandé pourquoi. Je me serais abandonnée si j’avais pu. Je me suis sentie seule et isolée. J’ai été déscolarisée pendant plusieurs mois, faute d’aménagements de cours adaptés. Je suis tombée en dépression.
Je n’ai plus souffert directement des jugements. J’étais arrivée à un stade où j’étais blasée. Je voyais ce qui se tramait autour de moi, mais j’avais des choses plus importantes à gérer. En même temps, quand une vieille femme avec une canne vous double en montant une côte, on ne peut qu’être blasé. Pourtant j’ai souffert de l’impact que ça avait sur ma famille. Ma mère n’a pas supporté le regard des gens sur moi. Elle fusillait du regard quiconque me fixait «comme une bête de foire» ou nous esquivait. Elle, le roc, a pleuré et moi, la raison de tout ça, j’ai dû la consoler. Je n’ai pas supporté de faire subir ça aux gens que j’aime. Mon père n’accepte toujours pas ma situation. Il n’accepte pas son handicap d’ailleurs, ni le regard des autres. Il n’y a pas de lien entre nos handicaps. Le sien est visible : il a eu un accident et a perdu l’usage d’un bras. Mais étant très manuel, il n’a jamais accepté cette perte. Il ne supporte pas que je me plante fièrement avec mon étiquette «handicapée» aujourd’hui, alors que lui se dérobe.
Moi qui me trouvais toujours grosse, j’ai perdu beaucoup de poids pendant cette période, au point de ressembler à un «zombie» d’après mes proches, toujours plus inquiets.
J’étais toujours en révolte contre moi-même et contre les autres : les profs peu compréhensifs, les administrations qui semblent vouloir nous enfoncer davantage. En même temps, je me suis mise à accepter ceux qui nous tendent toutes les mains possibles, nous regardent dans les yeux et non pas dans les roues.
J’ai fini par quitter le fauteuil et reprendre du poids. Du coup, je me suis à nouveau trouvée grosse. Éternelle insatisfaite. Néanmoins, une transformation s’était opérée. J’ai commencé mes études supérieures et j’ai appris à m’ouvrir aux autres. J’avais fini par accepter de dépendre désormais d’eux, j’ai décidé d’apprendre à les connaître. Et ils m’ont surpris ! L’amour que j’ai pu lire dans leurs regards, le respect aussi parce qu’ils nous trouvent courageux.
En raison de ma santé, j’ai dû arrêter mes études. Nouvelle révolte contre mon corps. N’en pouvant plus de cette situation, j’ai entrepris un travail sur moi-même avec une multitude de professionnels (médecins ou infirmières) tous avec des spécialités propres : psychologie, réflexologie, ostéopathie, kinésithérapie, sophrologie… Un de mes problèmes concernait autant mon « je – nous » que mon genou. Avec eux, j’ai cherché à savoir pourquoi je ne m’aimais pas, pourquoi je n’acceptais pas ce que j’étais et donc ce que je pouvais renvoyer comme image. Celle d’une jeune femme froide, indépendante. J’ai eu du mal : une partie d’entre eux me voyaient toujours comme une comédienne mais certains ont eu ce regard lumineux qui aide à relever la tête.
C’était en 2011. Aujourd’hui, cinq ans après je suis toujours malade, mais je vais bien. J’ai appris à accepter mon corps, voir à l’aimer partiellement. Je ne me trouve ni moche ni grosse, juste moi. Je ne me compare plus aux autres. Je suis une fille sans répondre aux clichés de l’étudiante ou aux « normes socialement admises », je suis simple et naturelle. Je suis. C’est tout ce qui compte réellement.
Aujourd’hui, j’ai appris à faire sans le regard des autres. Je ne suis plus aussi timide. Je suis plus expressive et plus souriante. Je dis des bêtises, j’agis comme si personne ne me regardait. Je me moque de ce qu’on pense de moi. Je me suis fait tatouer pour dire à mon corps que je l’accepte. J’ai enfin compris qu’il y aura toujours des gens qui ne m’aimeront pas et d’autres qui m’accepteront telle que je suis. Toutefois, je n’arrive toujours pas à accepter un compliment. Je ne le remarque pas si je plais à quelqu’un. Je n’aime pas le regard des hommes sur moi. Je préfère ne pas le voir. Il est gênant. Il me renvoie une image sexualisée qui ne me plaît pas, que je n’assume pas.
Je pense qu’être tombée malade est finalement une bonne chose. C’est bizarre de dire ça, mais ça m’a aidé à avancer, à mieux vivre avec moi-même. La vie est assez compliquée : évitons-nous ces attentes inutiles que nous croyons que les autres ont de nous. C’est mon impression. Je ne suis pas tout un tas de choses, et alors ?
J’ai encore du travail à faire sur moi-même, je le sais. Je ne m’aime pas encore, pas assez. Mais j’évolue, avec les autres. J’écoute mon corps. Ma santé s’est même améliorée, donc je tends vers l’harmonie. La preuve que j’ai changé : je suis prête à me faire prendre en photo alors que j’avais jusque-là toujours esquivé.
Finalement, le regard des autres ça se soigne.
Note *Mélissa utilise beaucoup « nous » car elle considère qu’elle fait partie d’un ensemble de personnes qui se battent pour eux-mêmes et que c’est cet ensemble qui est « courageux », pas elle. Cette généralisation lui permet de dire à la première personne du pluriel des choses qu’il lui serait impossible autrement.
- Texte : collaboration entre Mélissa & Noémie Louessard
- Correctrice : Camille Louessard.